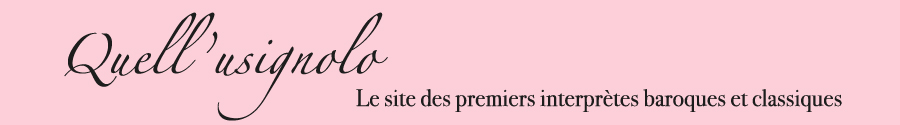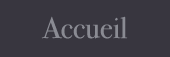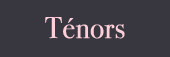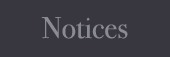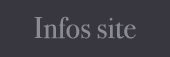Ce castrat est issue de l'école de Bernacchi à Bologne, sa ville natale.
En 1732-33, encore tout jeune et soprano, on le découvre à Rome et Viterbe dans les derniers rôles, à commenser par le Lucio Papirio de Porta. Constamment présent à Rome jusqu'en 1738, il assure vite les rôles féminins, comme seconda ou prima donna, par exemple dans l'Achille in Sciro d'Arena avec les castrats Pignotti et Gizziello.
À partir de 1738, le castrat paraît à Florence, Venise, Gênes, etc. dans les premiers rôles masculins. Il chante Lampugnani avec le vieux Bernacchi, son professeur, à Ferrare.
Amadori est Serse dans le Temistocle de Bernasconi à Padoue en 1740, et primo uomo en 1746 à Livourne dans Siroe de G. Scarlatti, ou dans le Bajazet de Cocchi à Rome, avec Gherardi ; on l'applaudit à Palerme (1743, Artaserse de Vinci) ou encore Bologne puis Rome à nouveau en 1746, avec le ténor Laschi. Néanmoins il s’efface derrière Caffarelli, Elisi, ou Monticelli au sein des brillantissimes distributions des saisons 1748-49 au San Carlo de Naples, avec Cocchi, Perez ou Jommelli (Ezio) à l'affiche.
Il rencontre le succès à Vienne dans le pasticcio Euridice en 1750, ou il interprète Orphée sur des musiques de Jommelli, Hasse, Wagenseil, Holzbauer, etc. Amadori y interprète plusieurs autres opéras (Abos, Perez), accompagné de l'immense tragédienne du siècle, la contralto Tesi, récemment installée en Autriche, ainsi que du ténor Amorevoli. C'est avec la Mingotti et Babbi qu'il retrouve Naples en 1751. On l'entend aussi à Milan Gênes et Bologne. Fait marquant, il participe à la création de Ciro in Armenia à Milan en 1754, avec les sœurs Mattei et le jeune Priori : la musique, et peut-être même le livret sont de la plume de Maria Teresa Agnesi, rare compositrice jouée au théâtre en ce siècle.
Engagé en remplacement de Carestini à Berlin, il chante le rôle titre de Montezuma en janvier 1755 avec les sopranos Gasparini et Astrua, mais déplaît au roi, comme beaucoup de chanteurs : il est congédié dès l'été.
On l'entend de nouveau à Milan en 1756, avec la contralto Caterina Galli, puis encore à Bologne. Un Tedeschini annoncé comme musicien du roi de Prusse chante en concert à La Haye en 1758 : il s'agit probablement d'Amadori. Le dernier livret portant son nom date de 1761, pour le Caio Mario de Jommelli à Faenza.
Tedeschi s’installe ensuite à Naples, où il compose et ouvre une école de chant réputée. Le castrat est aussi contralto à la chapelle royale, poste qu'il occupe encore en 1770 lorsque les Mozart sont en ville. Amadori exerce des fonctions d'imprésario pour le théâtre royal : on trouve notamment sa dédicace dans le livret du LucioVero de 1766.
Le magnifique rôle de Montezuma met en valeur toutes les facettes dont doit disposer un grand belcantiste : maîtrise sur toute la tessiture, en particulier le grave, élégance dans l'adagio, finesse de l'ornementation, bravoure et déclamation éloquente quand nécessaire. Soprano au départ, Amadori termine sa carrière comme contralto. |